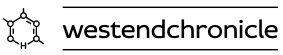Les gouvernements étatiques et municipaux distribuent fréquemment du sel comme agent de déglaçage sur les routes. Il agit en abaissant efficacement la température de fonte de la glace. Ce phénomène, connu sous le nom de dépression du point de congélation, constitue également la base de divers projets scientifiques. Les projets peuvent aller du plus simple au plus complexe - avec des prédictions mathématiques - en fonction du niveau scolaire de l'élève. De plus, la liste du matériel requis ne comprend qu'une casserole et un thermomètre.
Lorsque les solides se dissolvent dans l'eau, ils forment de petites particules discrètes. Dans le cas de substances organiques comme le sucre, les particules sont constituées de molécules de sucre individuelles. Dans le cas des sels, tels que le sel de table, également connu sous le nom de chlorure de sodium, les particules sont constituées des ions chargés qui composent le sel. La présence de particules dans l'eau interfère avec la capacité des molécules d'eau à se lier pour former un solide lorsque la température de l'eau approche de son point de congélation. La dépression du point de congélation se produit dans tous les liquides, pas seulement dans l'eau.
Un expérimentateur doit porter une attention particulière à ce qu'il mesure exactement et à la manière dont il le mesure. Cela revient à la question fondamentale de poser les bonnes questions. Dans ce cas particulier, l'expérimentateur doit-il se préoccuper de ce qui gèle plus vite, ou de la température à laquelle se produit le gel? La question de savoir ce qui gèle plus rapidement implique que si un échantillon d'eau et un échantillon d'eau sucrée étaient placés simultanément dans un congélateur, alors l'un d'eux gèlerait avant l'autre. Mais quelles informations cela fournirait-il réellement? La vitesse à laquelle une substance gèle est liée, entre autres paramètres, à la capacité thermique et la quantité de matière. Le meilleur choix dans ce cas serait de mesurer la température à laquelle les solutions gèlent car cela répond à la question la plus importante: les impuretés dans l'eau affectent-elles son point de congélation et, si oui, de quelle manière? beaucoup?
Les chimistes et les physiciens ont bien établi la science et les mathématiques derrière la dépression du point de congélation. Pour les étudiants avancés ou ceux qui s'intéressent beaucoup aux mathématiques, l'équation standard pour l'abaissement du point de congélation, delta (T), d'une solution est delta (T) = -k * m, où k représente la constante d'abaissement du point de congélation molaire du solvant et m représente la molalité de la solution, ou les moles de particules divisées par les kilogrammes de solvant. Cela semble plus compliqué qu'il ne l'est en réalité. En supposant que l'eau représente le seul solvant utilisé dans l'expérience, k = 1,86. De plus, le sucre, également connu sous le nom de saccharose, présente un poids moléculaire de 342,3. L'équation pour l'abaissement du point de congélation se simplifie maintenant en delta (T) = -1,86 * (grammes de saccharose / 342,3 / kg d'eau). Ainsi, par exemple, si 10 grammes de saccharose ont été dissous dans 100 ml d'eau, alors 100 ml = 100 g = 0,100 kg, et delta (T) = -1,86 * (10 / 342,3 / 0,1) = -0,54 degrés Celsius. Ainsi, cette solution doit geler à une température de 0,54 degrés Celsius en dessous du point de congélation de l'eau pure.
Réorganiser l'équation à partir de l'étape 3 permettrait à un expérimentateur de mesurer delta (T) puis de résoudre le poids moléculaire, MW, du saccharose. C'est-à-dire MW = (-1,86 * grammes de saccharose) / (delta (T) * kg d'eau). En fait, de nombreux étudiants en chimie du secondaire et du collégial mènent des expériences dans lesquelles ils déterminent expérimentalement le poids moléculaire d'une substance inconnue. La méthode fonctionne également en ce qui concerne les points d'ébullition, sauf que la valeur de k passe à 0,52.